Etude et analyse
L’expression Indopacifique est apparue sur les radars du grand public avec l’affaire des sous-marins australiens. Concomitamment avec la rupture d’un contrat de 56 milliards d’euros avec la France a été annoncée une alliance stratégique entre l’Australie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis (dénommée AUKUS). A quelque chose malheur est bon, le scandale diplomatique qui s’en est suivi a braqué tous les projecteurs sur cette partie du monde. Dans cette zone immense qui est devenue, en ce début du XXIème siècle, le centre de gravité de la croissance et des échanges internationaux, les Etats-Unis entendent peser de tout leur poids, afin d’endiguer l’expansion chinoise. Sur ce point, l’administration Biden s’inscrit dans les pas de Trump, et va même encore plus loin. Paralysés par leurs multiples dépendances – militaire vis-à-vis de l’Amérique, économique par rapport à la Chine – les Européens ont quelques difficultés à ne serait-ce que saisir les enjeux.
Nouvelle ère, nouvelle cartographie
Il y a dix ans, personne, en dehors d’un cercle restreint de spécialistes, n’avait entendu parler d’Indopacifique au sens géopolitique. Aujourd’hui, aux Etats-Unis utiliser l’expression usuelle Asie-Pacifique passe pour démodé et/ou trop complaisant avec la Chine. Le nouveau terme désigne, avec des délimitations variées, une aire géographique couvrant deux océans, articulé autour de l’axe Chine, Inde, Asie du Sud-Est, Australie, avec Singapour et le détroit de Malacca au centre. Il fut employé à l’origine par les acteurs de la région, en particulier le Japon, pour signifier la connectivité des deux océans et y organiser une réaction face à l’expansionnisme chinois incarné par les Nouvelles routes de la soie. Dès le départ, Pékin le rejette et parle d’une « idée pour attirer l’attention » qui va « se dissiper comme l’écume des océans ».
L’Amérique, elle, finit par reprendre le terme à son compte, au point de rebaptiser en 2018 son Commandement du Pacifique en USINDOPACOM. Il n’en reste pas moins que le concept de l’Indopacifique tire sa raison d’être de deux inquiétudes parallèles : la montée de la Chine et… les incertitudes qui pèsent sur l’engagement américain. Aux doutes sur la solidité des garanties US, aggravés par l’imprévisibilité sous Donald Trump, s’ajoutent les interrogations quant à la capacité même des Etats-Unis de s’imposer dans la zone, au vu des simulations (war games) qui se terminent régulièrement par la défaite de l’Amérique face à la Chine. Il y a donc deux manières, non exclusives l’une de l’autre, de voir les initiatives qui se multiplient en Indopacifique : un levier pour renforcer la présence américaine (à travers un réseau d’alliance où Washinton reste le maître du jeu), mais aussi un moyen, pour les puissances de la région, de s’organiser entre elles, afin de pallier une éventuelle diminution du rôle de l’Amérique.
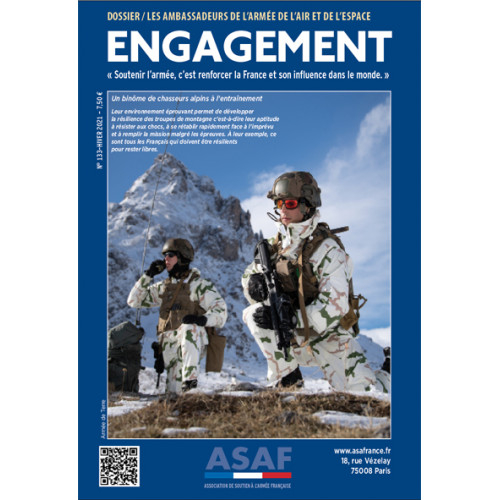
Politique américaine : variations et constantes
Aux Etats-Unis, il y a maintenant un large consensus pour dire que la politique poursuivie depuis la fin de la guerre froide vis-à-vis de la Chine – basée sur l’intégration de celle-ci dans le système mondial dans l’espoir qu’une libéralisation interne allait suivre – fut pour le moins contre-productive. Le général Henry McMaster, ancien Conseiller à la sécurité nationale sous Donald Trump et l’artisan du changement d’attitude envers la Chine résume 30 ans d’égarement ainsi : « Depuis 1990, la politique US vis-à-vis la Chine a comporté tous les éléments du narcissisme stratégique : on prend ses désirs pour des réalités, on voit l’autre à sa propre image, les analyses sont biaisées pour étayer un argumentaire préétabli, et on nourrit l’idée que les autres vont se conformer à un scénario écrit par les Etats-Unis ». L’administration Obama a encore entretenu, peu ou prou, ces illusions, même si, face à la montée spectaculaire de la Chine, elle a annoncé un « repositionnement » des efforts et de l’attention vers l’Asie : le soi-disant « pivot ».
La nouvelle équipe Trump n’a pas fait dans la dentelle : un durcissement spectaculaire de la vision et de la rhétorique s’est opéré en 2017-2018 – avec un soutien bipartisan au Congrès. La stratégie pour l’Indopacifique, publié par le Pentagone en juin 2019, part du constat que « la Chine veut réordonner la région à son avantage » et qualifie Pékin de « puissance révisionniste ». Le document parle d’une « érosion » de la supériorité militaire américaine vis-à-vis la Chine et préconise la coopération accrue avec des alliés et partenaires en tant que « multiplicateurs de la puissance » des Etats-Unis. Il mentionne aussi « une rivalité géopolitique entre deux visions du monde, l’une libre, l’autre répressive », et marque l’engagement des Etats-Unis pour « une Indopacifique ouverte et libre » ; un concept a priori plus fédérateur que ne l’était « le pivot » de la précédente équipe.
Dès son arrivée au pouvoir, le président Biden s’inscrit dans cette ligne dure, et prévoit une « extrême compétition » avec Pékin. Le document de stratégie intérimaire, publié en mars dernier, écrit noir sur blanc que « la Chine est le seul rival qui soit potentiellement capable de rassembler sa puissance économique, diplomatique, militaire et technologique pour poser un défi durable à un système international ouvert et stable ». Face à cela, l’administration Biden multiplie les initiatives. Que ce soient des ventes d’armes, l’extension des bases, ou la revitalisation (voire la mise en place) d’alliances à géométrie variable. Parmi ses succès il est à noter l’adoption, au sommet de l’OTAN en juin, d’une déclaration affirmant : « L’influence croissante et les politiques internationales de la Chine peuvent présenter des défis, auxquels nous devons répondre ensemble, en tant qu’Alliance ».
La zizanie en Europe
Mi-septembre, le timing aurait difficilement pu être plus catastrophique entre alliés. Comme le dit le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell : « Le jour même où je suis venu présenter la Stratégie de l’UE pour l’Indopacifique, les Etats-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni ont annoncé leur alliance militaire indopacifique pile à la même heure ». L’UE n’avait été ni informée, ni consultée, a-t-il tenu à ajouter. Aurait-on voulu signifier aux Européens qu’ils étaient marginalisés (en leur préférant un recentrage sur l’alliance entre Anglo-Saxons, et en éjectant d’un contrat pharaonique la seule puissance européenne en Indopacifique), on ne s’y serait pas pris autrement. Raison de plus pour que l’Union adopte une ligne commune ? Un récent rapport du European Council on Foreign Relations, sur « Les visions européennes de l’Indopacifique » met en lumière qu’il y a, dans l’UE, autant de lignes que de pays. Certains regardent la région sous un angle économique, d’autres ont une approche plus géopolitique. Pour quelques-uns la stratégie européenne est un moyen d’affirmer « l’autonomie », pour le reste, en revanche, elle a pour fonction de donner des gages à l’Amérique et lui rendre service dans l’Indopacifique.
Il est compliqué, dans ces conditions, de faire valoir à l’échelle européenne une quelconque « divergence d’approche avec les Etats-Unis ». Le ministre Jean-Yves Le Drian s’y essaie quand il répète : la France tient compte de la militarisation croissante de la Chine, mais ce n’est pas pour autant qu’elle se place d’emblée dans « une logique d’affirmation confrontationnelle ». Paris met l’accent sur les enjeux de liberté de navigation et de respect du droit de la mer, et souhaiterait étendre à l’Indopacifique le nouveau « concept de présences maritimes coordonnées » de l’UE, censée assurer une présence navale quasi permanente dans une « zone d’intérêt ». La France espère rallier à ses positions le plus de partenaires possibles d’ici la tenue d’un sommet indopacifique au premier semestre de 2022, lors de la présidence française de l’UE.
Le serpent qui se mord la queue
A son audition de confirmation au Sénat, en janvier 1997, Madeleine Albright – futur Secrétaire d’Etat du président Bill Clinton – affirme : « l’Amérique doit rester une puissance européenne. Nous devons, et nous allons, rester une puissance du Pacifique aussi ». Durant le quart de siècle qui a suivi, cette double exigence a de plus en plus pris l’allure d’un Catch-22 pour les Etats-Unis. La crise en Ukraine, en plein « pivot » vers l’Asie, en a constitué, jusqu’ici, le paroxysme. Pour rappel : début 2012, l’administration Obama annonce un rééquilibrage des efforts US au profit du continent asiatique, provoquant un véritable traumatisme au sein de l’Alliance atlantique. Deux ans après, la crise en Ukraine éclate et les alliés européens s’empressent de souligner à quel point elle confirme la centralité de l’OTAN et du lien transatlantique. Mais au même moment, et pour cette exacte même raison, les alliés asiatiques deviennent fébriles. Le président Obama part donc faire une tournée en Asie, en pleine crise avec la Russie, pour rassurer les alliés du Pacifique.
Et les injonctions contradictoires ne s’arrêtent pas là. Car tout en voulant figurer en tête de la liste des priorités de l’Amérique, les alliés asiatiques ont aussi jugé insuffisant la réaction de Washington en Ukraine, face à la Russie. Ils craignaient que les événements sur le théâtre européen ne soient interprétés par la Chine comme une preuve de faiblesse américaine et n’encouragent Pékin à tenter sa chance en Asie-Pacifique. Bref, en Asie, les alliés attendent un redéploiement des efforts américains vers leur région, pour se rassurer que l’engagement indopacifique ne soit pas que des « paroles ». Dans le même temps, ils scrutent ce qui se passe en Europe et tout allègement des efforts ici les fait douter de la fiabilité des Etats-Unis. La situation devient de plus en plus inextricable, à mesure que les doutes vont croissant quant à la capacité et la volonté de Washington de tenir ses engagements et que, parallèlement, il continue à étendre la zone (Indopacifique) et l’ambition (lutte idéologique entre autoritarismes et démocraties) de ces engagements.
En théorie, il existe une voie toute tracée pour sortir par le haut de cette double contrainte. Il suffirait, comme l’a dit la chancelière Merkel exaspérée par l’impétuosité du président Trump, que « les Européens prennent en main leur propre destin ». Qu’ils se donnent les moyens, s’agissant de leur propre défense, de ne plus être à la merci de leur allié américain et qu’ils libèrent ainsi les forces US pour se concentrer sur le théâtre indopacifique et « l’extrême compétition » avec la Chine. A ceci près qu’une Europe qui ne se sentirait plus militairement, existentiellement dépendante des Etats-Unis, serait mécaniquement moins réceptive face aux exigences de l’Amérique dans d’autres domaines, commercial, technologique, économique. Or Washington estime avoir besoin, aujourd’hui plus que jamais, de pouvoir actionner tous ces leviers européens face à la Chine. Du côté européen, la situation n’est pas moins ambivalente. Comme l’a remarqué récemment l’ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, lors d’une audition à l’Assemblée nationale : compte tenu du penchant neutraliste-pacifiste des partenaires européens, en cas de départ des Américains, « l’Europe puissance à la française ne serait pas forcément majoritaire ».
Ce n’est pas un hasard si tant de pays européens acceptent avec une facilité déconcertante des vulnérabilités par rapport à la Chine, qu’il s’agisse de cession de contrôle sur des infrastructures critiques ou d’accueil d’équipements de télécommunication Huawei. Illustration, s’il en faut, combien il est facile de basculer d’une dépendance à l’autre, une fois que les matrices de sujétion sont bien ancrées. Aussi paradoxal que ce soit, rien ne dit que sans le « leadership » américain les Européens, dans leur ensemble, ne seraient pas tentés par une politique d’apaisement, voire de soumission envers la Chine, plutôt qu’une affirmation de puissance et d’indépendance.
Hajnalka Vincze, Les Etats-Unis retentent leur « pivot » vers l’Asie, cette fois-ci sous le nom d’Indopacifique, article paru dans le numéro 133 de la revue Engagement de l’ASAF (Association de soutien à l’armée française).




















